Pouvoirs de la fiction
Entretien avec Vincent Jouve
Propos recueillis par Jean-François Vernay
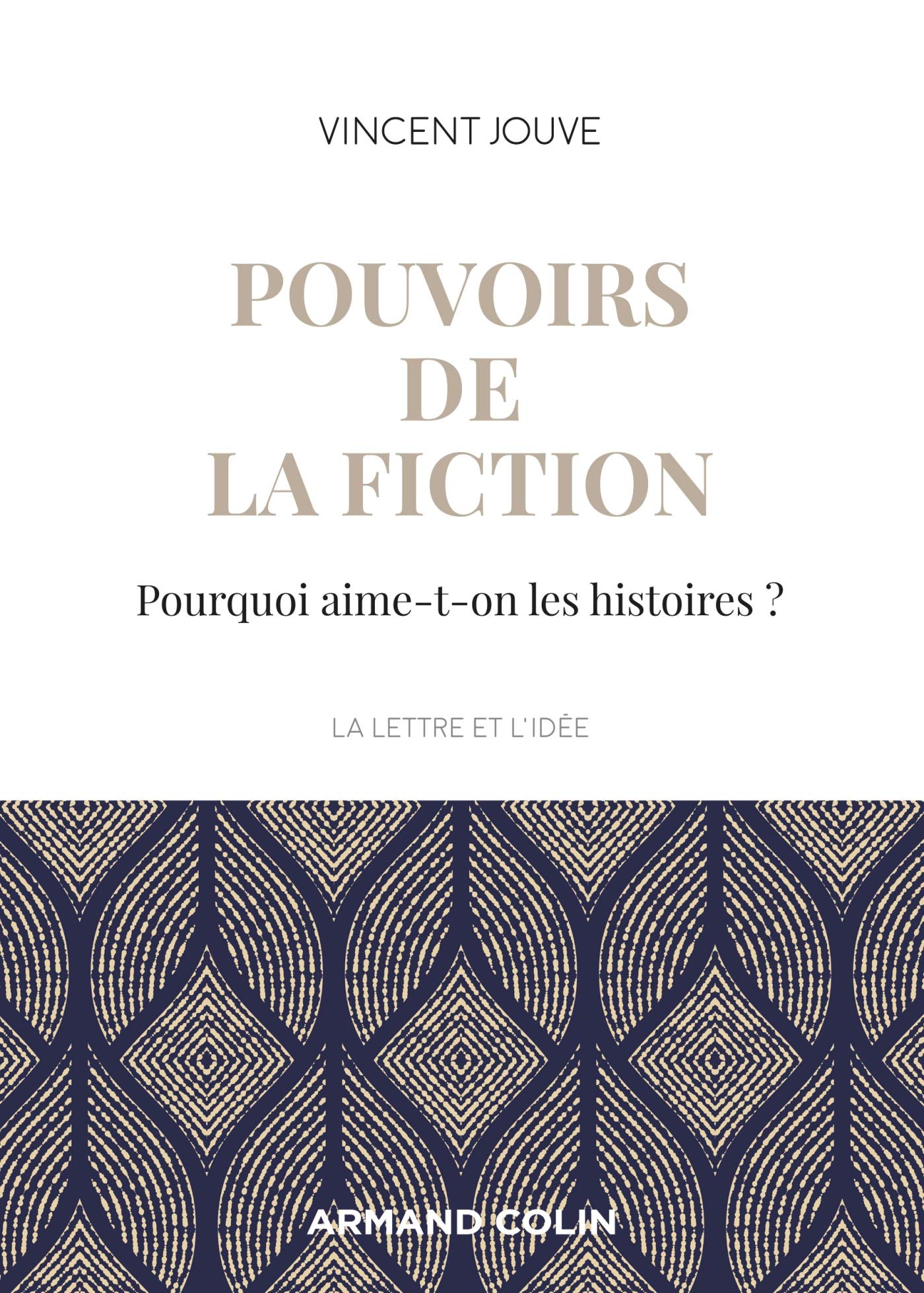
Avec Pouvoirs de la fiction : Pourquoi aime-t-on les histoires ?, Vincent Jouve mène l’enquête dans le champ herméneutique afin de déceler les indices responsables de notre attrait neurocogntif pour les scénarii imaginaires. Dans un ouvrage d’une grande clarté didactique et qui n’est pas dénué d’humour, il brosse les grands traits du cadre théorique des éléments responsables de notre engouement pour le récit fictionnel, avant d’illustrer son propos avec une mise en application de ses principes sur les textes d’Émile Zola, de Marcel Proust et de Marguerite Duras.
Jean-François Vernay : De quand date ce projet ? Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux pouvoirs de la fiction ? Pouvez-vous contextualiser cet ouvrage dans votre parcours éditorial et dans le champ de la critique littéraire francophone ?
Vincent Jouve : J’ai commencé à travailler à cet essai, il y a à peu près cinq ans. Comme beaucoup d’universitaires formés à la poétique et à la narratologie, j’ai longtemps été mal à l’aise avec la notion de « fiction », que chacun comprend intuitivement mais qu’il n’est pas si facile de définir. Si l’on entend par « récit de fiction » un récit « inventé » (par opposition à un récit « véridique », comme un témoignage ou une autobiographie), la question qui se pose est de savoir s’il existe des traits définitoires du texte fictionnel : y a-t-il une langue ou une écriture de la fiction que l’on peut décrire objectivement ? Parmi les théoriciens, il n’y a pas consensus sur ce point, et l’on trouve des clivages du même type que lorsqu’on s’interroge sur l’existence d’une langue de la littérature.
Si, malgré mes réticences, j’ai finalement choisi d’aborder le problème frontalement, c’est d’abord parce que la notion de « fiction » est entrée en force dans l’enseignement universitaire, par le biais des études culturelles et de la philosophie de l’art. Pour les culturalistes, qui travaillent de moins en moins sur les textes et de plus en plus sur les films, les séries télévisées et les bandes dessinées, le terme « littérature », par son côté élitiste et institutionnel, était problématique, et le terme de « fiction », plus général et plus neutre sur le plan des valeurs, s’est naturellement imposé. Il devenait donc difficile pour les littéraires de l’ignorer.
Une autre étape importante, dans ce processus, a sans conteste été la parution de l’ouvrage de Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ? La question y était abordée du point de vue des sciences cognitives et de l’anthropologie ; mais l’essai (paru aux éditions du Seuil dans la collection « Poétique ») a eu une grande audience chez les littéraires, qui se sont naturellement emparés de la notion.
Je n’ai pas tardé à m’apercevoir que les études sur la fiction se situaient dans le droit fil des théories de la lecture – sur lesquelles je n’ai jamais cessé de travailler. Comme Michel Picard le rappelait avec force dans les années 1980, le récit, saisi dans sa globalité, n’est pas seulement un ensemble de signes demandant à être interprété, mais une illusion de monde sollicitant notre imaginaire et nos émotions, ce dont rend parfaitement compte la notion de « fiction ».
Au-delà de mon itinéraire personnel, je dirais que le recentrage de la théorie littéraire sur ce que vit et ressent le lecteur (après plusieurs décennies qui s’intéressaient prioritairement, voire exclusivement, au fonctionnement du texte) est sans doute aussi un trait d’époque : nous vivons de plus en plus dans des mondes virtuels interactifs qui partagent de nombreux traits avec les univers fictionnels, et analyser la façon dont nous habitons ces derniers présente un intérêt qui dépasse largement le cadre des études littéraires.
Jean-François Vernay : Considérez-vous avoir fait une contribution aux études littéraires cognitives avec Pouvoirs de la fiction ? Quel est votre regard sur ce champ critique novateur ?
Vincent Jouve : Tout dépend de ce qu’on entend par « études littéraires cognitives ». La formule, comme vous le savez, a connu un tel succès qu’on l’invoque dans des domaines de recherche très variés qui vont des théories de la lecture à la nouvelle narratologie en passant par les études culturelles. Disons que si, par « sciences cognitives », on désigne les disciplines qui étudient les mécanismes de l’activité cérébrale, il y a deux grandes façons de les utiliser dans la recherche littéraire : comme point de départ (pour mieux comprendre ce qui se passe chez le lecteur lorsqu’il lit un texte de fiction) ; comme point d’arrivée (en se demandant comment la lecture des textes fictionnels aiguise et renforce nos capacités d’attention, de mémorisation et de réflexion et, plus généralement, notre capacité d’interagir avec notre environnement).
Même si ma contribution reste fort modeste, j’ai tenté d’explorer ces deux points – la lecture en tant que processus cognitif ; la façon dont la littérature aide au développement de nos facultés mentales – en me posant les questions suivantes : comment un récit parvient-il à retenir notre attention ? à aiguiser notre intérêt ? à faciliter notre immersion dans l’univers du texte ? Comment génère-t-il de l’émotion ? Quel type de plaisir procure-t-il ? Que nous apporte-t-il, après coup, dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes et dans notre relation aux autres ?
Ce qu’ont permis les approches cognitives, c’est une meilleure compréhension de ce que nous apportent les textes au-delà du seul bagage culturel. Mais le danger, c’est d’en rester à une forme de généralité (dégager ce que nous procure la fiction en tant que pratique anthropologique universelle) en oubliant (ou en rejetant au second plan) la singularité de chaque texte. Tous les textes ne se valent pas et certains nous enrichissent plus que d’autres. Une fois dégagées les vertus globales de la littérature de fiction, il reste à savoir comment elles se déclinent dans chaque texte, avec plus ou moins de bonheur et d’efficacité. C’est cette dialectique du général et du particulier que j’ai tenté d’illustrer en fin d’ouvrage à travers l’analyse de passages textuels précis.
Jean-François Vernay : Que pensez-vous des thèses du darwinisme littéraire (PF: 114) ? Pourriez-vous être un de ses tenants ?
Vincent Jouve : Le courant du darwinisme littéraire, qui entend penser le fait artistique et littéraire à la lumière de la théorie de l’évolution (en quoi la pratique artistique permet-elle à l’homme de s’adapter à son environnement ? peut-on ranger notre tendance à forger des fictions parmi les traits qui favorisent notre survie et notre progression en tant qu’espèce ?) pose la question centrale de l’origine de la littérature et de sa fonction dans le développement humain. Certaines réponses sont intéressantes ; d’autres me semblent plus problématiques quand elles ne sont pas franchement fantaisistes.
J’adhère sans difficulté à l’idée que la fiction peut être un instrument d’adaptation sociale (en nous familiarisant avec l’altérité, en nous plongeant dans des situations virtuelles qui nous permettent d’accroître notre expérience) ou une réponse à l’angoisse existentielle (en embellissant la vie et en nous aidant à croire qu’elle peut s’améliorer).
En revanche, la théorie de la littérature comme « activité parasite », qui détournerait une fonction nécessaire – le langage – pour en faire un simple instrument de plaisir (un peu comme la pornographie détournerait les mécanismes biologiques de la reproduction) ou celle de l’art comme « aide à la sélection sexuelle » (de même que la queue du paon et les ramures du cerf ne servent pas à grand-chose en termes d’adaptation mais sont un moyen de séduire les femelles, l’aura de l’artiste et de l’écrivain serait d’abord un atout dans la recherche d’un partenaire) me laissent dubitatif.
Plus globalement, le problème que me posent ces théories est qu’elles portent sur le fait artistique et littéraire en soi beaucoup plus que sur telle ou telle œuvre particulière. On retrouve un peu le même problème que pour les approches cognitives. Il existe, certes, un certain nombre d’analyses de texte au sein du darwinisme littéraire, sur L’Iliade ou sur Madame Bovary, par exemple, mais elles ne me semblent pas avoir donné des résultats très probants. En général, elles se focalisent sur un aspect du contenu : que nous dit le texte d’Homère sur les instincts de reproduction et de conservation propres à l’être humain ? Comment Emma, surdéterminée par des impératifs biologiques, va-t-elle s’y prendre pour sélectionner le meilleur partenaire possible ? Disons que ce type d’analyse est plus intéressant pour les anthropologues que pour les littéraires.
Jean-François Vernay : S'il vous était donné la possibilité de publier une édition augmentée de Pouvoirs de la fiction, sur quels autres aspects de la « force d'attraction du narratif » (PF : 7) les nouveaux chapitres porteraient-ils ?
Vincent Jouve : Dans l’essai tel qu’il se présente actuellement, je n’ai en effet retenu que les aspects qui sont, à mes yeux, les plus importants. Il me semble que les trois principaux ressorts du plaisir narratif sont l’émotion (j’attends d’un récit qu’il me fasse vibrer), l’intérêt (un récit peut retenir mon attention par son côté défamiliarisant ou sa richesse herméneutique) et la dimension esthétique (la capacité d’un texte à me procurer le sentiment du beau). Il est évident que ces trois ressorts sont souvent en interaction au cours de la lecture, en particulier l’intérêt et l’émotion que certains chercheurs préfèrent ne pas distinguer : un récit qui procure des émotions n’est-il pas, mécaniquement, un récit qui suscite de l’intérêt ? Ce sont les travaux de J.-L. Dessalles qui m’ont convaincu de les différencier. L’intérêt contient en effet une dimension épistémique qui n’est pas toujours présente dans l’émotion. Comme tout lecteur peut le constater, il y a des récits qui intéressent sans véritablement émouvoir et d’autres qui émeuvent mais sans qu’on considère leur potentiel en termes de savoir ou d’interprétation comme particulièrement notable. Je me suis donc rangé à l’idée que l’émotion et l’intérêt ne dépendaient pas des mêmes mécanismes, et j’ai tenté de les étudier séparément.
Bien sûr, le pouvoir de séduction du récit ne se limite pas à ces trois facteurs, comme vous l’avez bien montré dans votre livre, La Séduction de la fiction. On pourrait aussi, comme vous l’avez fait, évoquer la sensualité de l’objet livre, l’échange avec le narrateur et les personnages, la nature particulière de l’illusion fictionnelle, ou la diversité des parcours possibles au sein d’un même texte, pour ne citer que quelques éléments.
Dans l’optique d’une édition augmentée, j’aimerais développer la question assez complexe de l’identification. C’est un processus central dans la lecture de fiction, dans la mesure où il est à la croisée de l’émotion ressentie à la lecture et de l’expérience originale qu’elle procure. Qui ne s’est jamais identifié à un personnage ? Peut-on lire un récit sans se projeter, au moins partiellement, dans un ou plusieurs caractères ? Le problème est que cette notion d’« identification » est souvent employée de façon polysémique, ambivalente, et variable selon les critiques. Elle demande aussi à être définie par rapport aux autres investissements affectifs en jeu dans la lecture de fiction (empathie, sympathie, contagion émotionnelle), avec lesquels elle est parfois confondue. Je m’étais brièvement intéressé à la question dans un ouvrage maintenant ancien ; mais le développement de nouveaux instruments (issus principalement des sciences cognitives) demande qu’on y revienne. On pourrait, entre autres, tenter de répondre aux questions suivantes : L’identification est-elle partielle ou totale ? constante ou changeante ? uniforme ou plurielle ? Est-elle orientée par le texte ou dépend-elle du lecteur ? S’identifie-t-on au semblable ou au différent ? Il y a du pain sur la planche, et peut-être ce travail justifierait-il un ouvrage autonome.
Jean-François Vernay : Peut-on réconcilier la position théorique de la feintise (PF: 67) qui envisage la fiction comme espace du non-vrai (entendu comme espace qui échappe au vrai et au faux) et l'attribution d'une valeur cognitive à la fiction (PF : 133) qui, selon vous, propose « une autre façon d'apprendre » (PF : 123), postulat qui implique de concevoir la fiction comme espace du vrai ?
Vincent Jouve : C’est une question essentielle. Rappelons ce que Schaeffer entend exac-tement par « feintise ludique partagée ». Il s’agit, selon lui, du cadre pragmatique dans lequel se déroule la lecture des fictions. Ce cadre est celui du « faire semblant » : l’auteur fait semblant de croire à la vérité de l’histoire qu’il raconte et, en tant que lecteur, je fais semblant d’être dupe de l’illusion qu’il met en place. La feintise est donc « partagée » dans la mesure où auteur et lecteur savent tous les deux qu’ils sont dans la sphère du jeu (« ludique »). Comme vous le rappelez – Genette l’explique très bien dans Fiction et diction –, la question du vrai et du faux n’est pas pertinente à la lecture d’un roman : on ne lit pas une fiction pour accéder à une vérité (le romancier ne me demande pas de prendre au sérieux ce qu’il dit). Il est ainsi absurde de lire les romans comme des essais philosophiques témoignant des idées de leur auteur : dans la mesure où il s’agit bien de « romans », rien n’autorise à confondre l’auteur et le narrateur, voire – ce qui est plus étonnant encore – l’auteur et les personnages.
Le récit de fiction est donc, à la lettre, « irresponsable ». Mais c’est précisément cette irresponsabilité qui fait sa valeur. N’ayant pas à s’occuper des conséquences pratiques de ce qu’il dit (ou semble dire), il a un pouvoir d’exploration sans égal : il peut imaginer les situations les plus folles, proposer les expériences de pensée les plus délirantes, voire les plus choquantes, dans la mesure où, justement, il ne se donne pas à lire comme « discours sérieux » : un roman n’est pas un manuel de savoir-vivre. On peut cependant apprendre quelque chose d’expériences qui, se situant sur le plan de l’imaginaire, ne sont pas soumises à l’épreuve de la réalité. Si l’on définit les « expériences de pensée » comme des « exercices en imagination conçus pour dévoiler ce qui se passerait si certaines conditions étaient réunies » (Catherine Elgin), elles apportent quelque chose à notre compréhension du réel ( qu’est-ce qu’une hypothèse scientifique, non encore vérifiée, sinon une expérience de pensée ?). Kundera dit un peu la même chose lorsqu’il explique que le propre du roman n’est pas d’explorer ce qui est ou a été mais ce qui pourrait être.
Enfin, ce n’est pas parce que la fiction propose des histoires imaginaires qu’il n’y a rien d’authentique dans l’expérience de lecture. Lorsque nous lisons une fiction, nous ressentons de « vraies » émotions (nous sommes vraiment tristes quand le héros souffre, vraiment soulagés quand il s’en sort). Par ailleurs, les inductions et les réflexions que peut susciter un récit de fiction ne sont pas forcément moins profondes que les pensées que nous développons dans la vie quotidienne.
La fiction a donc bien une valeur cognitive au sens où elle contribue à informer – voire à transformer – notre appréhension de la réalité.
Jean-François Vernay : Dans votre commentaire sur la relation esthétique, champ théorique qui doit beaucoup à Gérard Genette, vous insistez sur la distinction entre plaisir fictionnel et plaisir esthétique (PF: 97). Pouvez-vous transposer cette distinction à l'art pictural en nous fournissant des définitions et illustrations ?
Vincent Jouve : Si l’on s’en tient à la conception de Genette, la relation esthétique se définit comme une attention portée à la forme de l’objet que l’on envisage sous l’angle du plaisir qu’elle procure : en d’autres termes, on se demande si cette forme nous plaît, si on la trouve belle. Cette approche s’applique parfaitement aux textes littéraires appréhendés comme des œuvres d’art. Mais beaucoup de textes littéraires, en particulier les récits, sont aussi des fictions. Or, une fiction ne peut s’évaluer uniquement sur la base de critères esthétiques. Pour qu’une fiction fonctionne efficacement, le lecteur doit pouvoir s’immerger sans difficulté dans le monde de l’histoire, croire un tant soit peu aux personnages mis en scène et s’émouvoir de ce qu’il leur arrive. Toutes ces exigences ne peuvent être remplies sans un effet de réel minimal. Il peut donc arriver qu’il y ait une tension entre plaisir esthétique et plaisir fictionnel : un texte qui affiche trop ouvertement le travail littéraire sur le langage court le risque de casser l’illusion référentielle nécessaire à l’immersion dans la fiction. Si le lecteur « voit » d’abord les mots, il ne croit plus vraiment au monde représenté. C’est un problème dont les romanciers réalistes avaient parfaitement conscience.
Ces considérations ne valent pas uniquement pour les fictions textuelles. Les mêmes problèmes se posent pour le cinéma ou la bande dessinée. Le cas de l’art pictural est plus complexe dans la mesure où il est peu narratif par essence (il s’agit d’un art de l’espace plus que d’un art du temps) : la transposition est donc délicate. Il y a cependant des tableaux qui laissent lire une narrativité à l’état virtuel et pour lesquels, en conséquence, on pourrait retrouver la distinction entre plaisir esthétique et plaisir fictionnel. A titre d’exemple, j’évoquerai Le Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau, tableau de 1717 considéré comme emblématique de « la fête galante », réunion d’amoureux qui s’entretiennent, en costumes de fête, dans un cadre naturel connotant le plaisir et le rêve. Le tableau de Watteau, qui représente le départ de l’île de Cythère, se décompose en plusieurs plans : au premier plan, on voit des couples s’attardant en haut de l’île sous la statue de Vénus ; un deuxième plan nous montre la procession des amoureux qui se dirige vers le bateau qui attend sur l’eau ; l’arrière-plan est envahi par le bleu de la mer et du ciel. Bien qu’exprimée à travers la simultanéité propre à l’art graphique, une narrativité est bel et bien présente : les trois plans correspondent aux différentes étapes qui mènent du sommet de l’île au rivage où mouille le navire. Le tableau vise clairement à susciter un plaisir esthétique à travers le travail sur la composition (répartition des personnages dans l’espace), la lumière (jeu sur les contrastes et l’intensité), les couleurs (touches d’or et de rose dans un ensemble où dominent le bleu et le vert) ou le trait (esquisses qui suggèrent le désir et le rêve). Mais on peut aussi éprouver un plaisir d’ordre fictionnel en s’immergeant dans le micro-récit que nous propose ce tableau : le choix de Watteau de représenter de dos les couples qui composent le cortège, par exemple, permet au spectateur de se situer au sein de l’espace représenté, c’est-à-dire d’entrer dans le monde de la fiction.
Jean-François Vernay : La fiction est-elle omnipotente ? Doit-on lui reconnaitre le droit et la capacité d'esthétiser la barbarie, pour reprendre votre exemple au sujet d'une recension sous la plume de Jean Améry (PF: 105) ?
Vincent Jouve : Vous faites allusion à un commentaire sur Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, prix Goncourt de 1970, mais auquel une partie de la critique reprocha un traitement équivoque de l’idéologie nazie (le roman se passe en partie pendant la Seconde Guerre mondiale) et une fascination pour l’enfance aux relents pédophiles. La question est de savoir si une œuvre littéraire, a fortiori s’il s’agit d’une fiction, doit être jugée sur le plan éthique. Personnellement, je pense que non dans la mesure où, comme je l’ai dit tout à l’heure, un récit de fiction ne prétend pas avoir d’application pratique. Encore une fois, ce qui fait qu’un roman peut tout se permettre – y compris une « esthétisation de la barbarie » – c’est qu’il ne se donne pas à lire comme un discours sérieux. J’ajouterai que rien ne permet d’attribuer à l’auteur les opinions et les déclarations de tel ou tel de ses personnages, voire du narrateur (qui est, lui aussi, une construction textuelle). Pour en revenir au Roi des Aulnes, le personnage principal, Abel Tiffauges, est qualifié à plusieurs reprises de « puéril » et de « crédule ». Et puis, si on décidait d’éliminer du corpus littéraire tous les textes moralement discutables, il n’en resterait plus beaucoup…
Cela dit, il est clair que le contrat d’irresponsabilité, selon moi inhérent à la lecture de fiction, connaît des ratés. Les polémiques sur le caractère « scandaleux » de tel ou tel roman reviennent régulièrement : il suffit de penser aux romans de Michel Houellebecq. On peut constater qu’il s’agit, chaque fois, de romans immédiatement contemporains. La conclusion que j’en tire est que le critère de la proximité temporelle joue un rôle non négligeable dans l’affaiblissement du contrat fictionnel. Quand un romancier parle du monde dans lequel nous vivons, nous avons tendance à recevoir aussi son texte comme discours sur le monde et, donc, à réagir aussi en tant que sujet du monde (nous sommes beaucoup moins sévères avec les textes du passé). Mais il s’agit là d’une perversion du contrat fictionnel, qui me semble hautement préjudiciable. La fiction est en effet un des derniers espaces d’absolue liberté et je m’inquiète de le voir attaqué de toutes parts. On peut à bon droit s’interroger sur la pertinence de l’ « avertissement » soulignant que le film Autant En Emporte le vent « nie les horreurs de l’esclavage » (comme si une fiction avait le même statut qu’un manuel d’Histoire) ou sur le projet de supprimer le baiser que donne le Prince Charmant à Blanche-Neige évanouie au motif qu’il serait non consenti (c’est oublier que la fiction utilise souvent un langage symbolique qui n’est pas à comprendre littéralement : en l’occurrence, la scène signifie simplement que l’héroïne « s’éveille à l’amour »). Le risque, si on continue sur cette voie, c’est de renouer avec la censure en étant victime de la confusion bovaryenne entre la littérature et la vie.
Jean-François Vernay : Dans quelle mesure cette vision anthropologique de la littérature a-t-elle changé votre perception de la fiction ? La littérature est-elle en train d'acquérir un nouveau statut ?
Vincent Jouve : Je m’interroge depuis longtemps sur les ressorts fondamentaux du récit et sur les raisons susceptibles d’expliquer ce qu’il faut bien appeler son « universalité ». Les études anthropologiques m’ont apporté une meilleure compréhension des mécanismes à l’œuvre et m’ont permis d’y voir plus clair dans la réponse à deux questions qui me préoccupent (et ne se recoupent pas complètement) : que recherche-t-on dans la littérature ? Quelle est l’utilité des études littéraires ? La première question concerne la lecture (qu’est-ce qui nous pousse à ouvrir un roman ?) ; la seconde l’éducation (pourquoi enseigne-t-on la littérature à l’école ?). Dans la mesure où l’anthropologie montre que la fiction est inséparable du fait humain et qu’elle joue un rôle dans notre développement, elle peut contribuer à éclairer ces problèmes.
Peut-on aller jusqu’à dire que la littérature a acquis un nouveau statut ? Ce qui est sûr, c’est qu’elle intéresse de plus en plus les autres disciplines, et pas seulement les sciences humaines. J’ai participé récemment à un ouvrage collectif, Médecins, soignants, osons la littérature (éditions Sipayat, 2019), qui se penche sur ce que la littérature peut apporter à la pratique médicale, en termes de soin (le récit remplit une fonction d’apaisement) comme en termes de savoir (la littérature a beaucoup à dire sur le malheur, le handicap, la vieillesse, la souffrance…). Ce dialogue est très stimulant et chaque discipline en ressort enrichie. Mais il y a peut-être un revers à cette médaille : qu’on oublie la spécificité de la fiction littéraire, notamment en termes de contrat de lecture, et qu’on la soumette au politiquement correct. La fiction a toujours été un espace d’exploration et d’expérimentation. C’est ce statut qu’il me semble indispensable de préserver.
Entretien publié le 08/05/2022