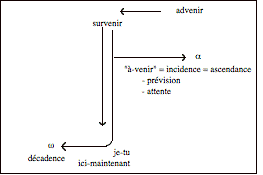Convocation
du devenir, éclat du survenir et tension
dramatique dans les récits
par
Pierre Sadoulet
Université Jean Monnet Saint-Étienne
«La
pratique du récit (…) a aussi une fonction de compréhension de
soi pour les personnes qui ont à objectiver leur appartenance
au moindre vécu dont elles font partie, en leur qualité actuelle
de participants à la communication. En particulier, elles ne
peuvent forger une identité personnelle qu'à condition de reconnaître
que la succession de leurs propres actions constitue une histoire
vécue susceptible d'être mise en récit.»
(Habermas Théorie
de l'agir communicationnel Tome II Traduction française.
Paris Fayard 1985)
Cette citation
d'Habermas montre l'un des enjeux de toute analyse du
devenir. Elle rappelle que la construction
du devenir par le sujet de la production de sens s'avère être une
praxis ayant un caractère identitaire. Comme le montre Jacques
Brès dans ses récents ouvrages sur la narrativité, c'est d'abord pour
se construire une vision unifiée et ascendante de l'agir que le
sujet raconte des histoires et ainsi se construit une vision unifiée
du temps et du devenir.
De ce fait,
la construction du devenir ne peut pas être seulement ramenée à une convocation de la continuité tensive
perçue par le sujet /92/ dit "protensif". Si une forme
du devenir peut être l'expérience d'un tel sujet qui n'aurait pas
encore complètement donné sens à ce qu'il vit, on peut faire remarquer
qu'une autre forme de continuité liée aux transformations narratives
est reconstruite, en fin de parcours, par la série d'opérations
propres à la mise en récit qu'il faudrait essayer d'analyser en
elles-mêmes. Il y aurait à côté d'un devenir protensif, un devenir construit comme une continuité de substance mise en clôture
dans l'unité d'un discours.
Pour arriver à comprendre l'ensemble des conditions
de la mise en signification du devenir et de la temporalité tels
qu'ils sont construits par les formes les plus fréquentes de la
mise en récit, nous proposons de prendre en compte des apports
de Guillaume dans ce domaine. La double direction qu'il a retrouvée
dans la représentation du temps constitue une analyse de la substance
sémantique du devenir construit qui permet de comprendre les tensions
qui, à tous les niveaux, constituent le devenir, ainsi que la façon
dont les sujets tentent de les résoudre, notamment à travers les
formes les plus populaires de la narration.
Par une analyse
rapide de plusieurs configurations particulières, nous voudrions montrer qu'on peut faire l'hypothèse
que la construction d'un devenir repose sur la mise en tension
entre le survenir qui est le fait de ce qu'on pourrait appeler un temps
objectif et les différentes formes d'anticipations de "l'à-venir" qui
auraient fait attendre éventuellement un autre déroulement. L'un
et l'autre flux que le sujet ne peut pas ne pas construire pourraient être
considérés comme deux formes de la convocation du devenir protensif,
que l'on définira, conformément aux propositions de Greimas Fontanille,
comme l'expérience de la schizie fondatrice qui serait la précondition
de la sémiosis.
/93/
Du fait de
la force dispersive que fait vivre le survenir dont la cursivité propre s'oppose à la "protensivité phorique", la construction des significations
temporelles se fait selon plusieurs modes différents d'appréhension
des procès, dont on retrouve les manifestations dans les différentes
catégories du temps et de l'aspect articulées par les systèmes
linguistiques. A côté du survenir, qui sera perçu comme cursif
ou ponctuel, on peut envisager la mémorisation d'un devenir objectif
mis en continuité comme survenu ou révolu (temps décadent). En
opposition tensive avec ce flux descendant, on peut envisager une
double signification anticipatrice : soit le sujet tente de
prévenir le survenir en essayant d'objectiver son anticipation,
de prévoir les événements "à venir". Il construira alors
une prévision. Soit le sujet affirme
une contre-nécessité —liée à son affirmation identitaire— en imaginant
un "à-venir" conforme à ses dispositions modales. Il
s'agit de l'attente d'un survenir particulier dont on verra le
rôle qu'elle joue dans la sensibilisation du devenir construit.
La mise en évidence du survenir qui constitue une "force dispersive" en
tension avec la "contre-nécessité" de l'attendu, permet,
en particulier, de postuler le fonctionnement sémiotique de la
tension dramatique, présupposée dans de nombreuses formes de récit,
notamment dans les médias modernes.
I) La
schizie du survenir et la perception du temps objectif
1. La double
visée du temps : ascendance et décadence.
Il est assez
connu que Gustave Guillaume analyse le présent de l'indicatif comme signifiant une épaisseur constituée
de deux vecteurs, le vecteur de futur ou incidence, le vecteur
du passé ou décadence. /94/ Nous dessinerons ainsi ce qu'il
a conçu, afin de mieux mettre en évidence la schizie propre à tout
devenir, qu'il s'agisse du devenir continu protensif ou du devenir
construit et articulé par les discours narratifs :
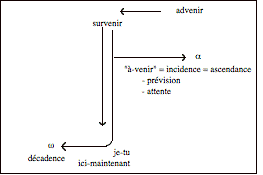
Par
ce schéma, nous analysons une tension fondamentale
propre à tout devenir puisque l'incidence de "l'à-venir" n'aurait
pas la même direction que la décadence du survenir.
Le temps y est conçu comme à double sens : un temps décadent,
qui a tous les caractères d'un temps objectif se déroulant du présent
au passé et un temps incident, construit en ascendance, c'est-à-dire
comme allant de l'observateur cognitif vers l'avenir, ce que nous
orthographions comme "l'à-venir".
A. La sagesse
populaire dit : "Ce
qui est fait est fait". La séquence décadente qui suit l'instant
du survenir, disons le survenu, échappe à /95/
toute potentialité. Son effet de sens est celui d'un état intangible,
une sédimentation d'être contre laquelle on ne peut plus rien.
Personne ne peut prétendre modifier son passé.
Ce révolu certes est susceptible de modalisations
diverses. Le sujet épistémique va donner sens à l'injonction dispersante
du survenir, ne serait-ce que pour échapper à la surprise de la
béance qu'il crée. Il peut lui associer des pathèmes depuis la
douleur et la souffrance jusqu'à la satisfaction la plus euphorique.
Plus largement, il peut prédiquer à son sujet toutes les formes
d'évaluations morales ou cognitives. Il peut même, par les opérations
propres à la mise en récit, le reconstruire totalement en ascendance, "logifié",
unifié dans une nouvelle causalité, moyen de prévoyance pour d'autres
occurrences. Quoi qu'il en soit ce survenir est là, inéluctable,
présentifié par la mémoire immédiate et l'activité de signification.
Le sujet ne peut plus rien pour lui.
B. Inversement
la portion incidente du présent
est nécessairement anticipation sur "l'à-venir".
De ce fait il reste, lui, encore porteur de potentialité. On peut
encore éviter "l'à-venir" incident. Tant qu'il n'est
pas révolu, du fait du survenir, "l'à-venir" reste à portée
de l'agir humain. Plus largement "l'à-venir" admet toutes
les modalités potentialisantes qui définissent les modes d'existence
modale du sujet.
Il y aurait
donc, dans la cursivité du survenir,
une scission, une négation de potentialité qui transforme de façon
définitive le remédiable en irrémédiable. La signification même
donnée par le sujet à cet objet particulier qu'est l'expérience
d'un survenir est la conséquence de cette schizie.
Cette contrainte,
qui tient évidemment à l'expérience
pratique de /96/ tout sujet humain, ne nous semble pas pouvoir
ne pas être prise en compte dans la description de la forme du
devenir, en tant que catégorie de la substance du contenu. Cette
propriété est, en particulier, à l'origine de "l'éclat " que
prend le survenir dans les discours narratifs : faire intervenir
le survenir au niveau discursif, c'est le mettre en tension avec
l'anticipation qui en est faite. S'il survient quelque chose, c'est
pour l'observateur, en opposition ou en cohérence avec une anticipation
de celui-ci, ce qui crée un effet de surprise qui peut, lui-même, être
diversement axiologisé. Et pour reprendre Sémiotique des passions, c'est la construction même de cette scission phorique
qui crée l'effet de sens caractéristique du devenir protensif.
Si
la protensivité est comprise comme l'effet modal
archaïque de la scission dans l'espace de la phorie, le devenir
en serait la version "positive", favorable à l'apparition
de la signification.
On notera
pour finir que le même ouvrage voit
dans cette opération le moyen pour le sujet de s'affirmer :
En
revenant à la manière dont l'émergence du sujet
protensif a été envisagée, on peut dire qu'il paraît sollicité par
deux forces congruentes mais quasi-contradictoires : d'une
part la protensivité, grâce à laquelle le sujet se différencie
de l'objet, et qui lui procure une image de son "ipséité",
et, de l'autre, la fiducie, cette façon d'être du "sujet pour
le monde", qui, parce qu'elle suspend cette différenciation
lui présente une sorte « d’altérité » .
/97/
Cela peut
nous renvoyer à la citation liminaire
d'Habermas.
B) L'agir
et la mise en ascendance.
Si l'on s'en
tient au niveau des préconditions
de la signification, on peut donc avancer que cette saisie de la
décadence temporelle présuppose le dépassement par le sujet constructeur
de la signification d'une sorte de fusion minérale avec le flux
des survenir. En effet ce flux décadent fait de l'individu tensif
qui se contente de le subir un simple objet du monde, non conscient
de ce qui lui arrive.
La mise en conscience suppose l'apparition de la scission modulée évoquée
par Greimas et Fontanille. Le proto-sujet opposerait alors une
protensivité phorique à la décadence du temps objectif. Grâce à une
telle scission, l'individu cesse d'être un non-sujet subissant
la décadence des survenues pour prendre la position d'un sujet,
c'est à dire, par définition, un actant visant un objet. De ce
fait, plus globalement, il affirme une individualité distincte
du monde et des autres.
La praxématique de Robert Lafont propose de
relier cette affirmation du sujet à un autre concept, celui de l'agir. C'est parce que le sujet humain veut
agir sur le monde qu'il s'efforce de projeter ses dispositions
modales, notamment son vouloir, sur le futur, seul espace du temps
où effectivement il peut agir. Du coup, il se trouve amené au sursaut
phorique par lequel il va inverser le sens du temps objectif. Le
sujet, dans sa volonté d'agir, se propose de ne reconstituer du
temps que sa partie prévisible modalisée par cette volonté. Il
opère donc /98/ des mises en intrigue. Il va par des opérations
de débrayage, convoquer le passé selon la même perspective ascendante,
en déplaçant la base temporelle de l'observateur.
Cette opération de mise en ascendance du temps
constitue un thème central des ouvrages récents de Jacques Brès
sur la narrativité. Elle atteint même "le temps du
racontant", comme dit l'auteur : « le temps du raconté correspond à la
retombée en objectivité mesurable — temps mort — de la
dynamique ouverte —temps vivant — par l’activité du dire sous-tendue par celle de l’à-dire que je propose d’appeler
le temps racontant … ».
Correspondant au temps du dire, il est comme lui ascendant. J’ai avancé tout à l’heure le terme de projet. Le temps racontant, qui se déroule dans l’ascendance
du dire, a la forme de l’agir : conquête de l’avenir à partir
du présent.
On tirera
de cette analyse — qui concerne
le réglage de la signification constituée en discours, autrement
dit ce que nous appelons le devenir construit — l'hypothèse
que la schizie phorique qui constitue le devenir protensif pourrait être
une des phases par laquelle s'opère ce retournement du temps. Cette
schizie du devenir serait le substrat qui créerait les bases de
la double forme de la temporalité : d'abord un devenir lancé,
si l'on peut dire, par le presque-sujet, un devenir tensif polémique
subjectivant, modalisé et sensibilisé, facteur d'identité, qui
constitue la base de l'attente.
A l'inverse,
il existe aussi un traitement de "l'à-venir" que nous dirions docile, réflexif, dominé par
les modalités aléthiques et, dans une certaine mesure, la fiducie :
il s'agit de la prévision,
toujours fidèle à l'objectalité, sinon à une objectivité rationalisante Elle
se /99/ développera en diverses opérations d'identifications ou
de reconnaissances qui vont procurer au sujet défini par la négation-sommation
un savoir catégorisé sur le monde.
La convocation
en discours du devenir va donc constituer le lieu d'une tension
polémique entre ces deux modes
différents d'appropriation du devenir, l'un en attente, selon les
divers dispositifs modaux liés à la narrativité, l'autre en prévision,
cherchant la conformité aux lois propres du monde naturel, l'analysant
donc en "décadence" possible.
Reprenant
les propositions de Jacques Brès,
on pourra faire l'hypothèse qu'il y aura, au même niveau de la
mise en discours, une troisième opération servant à combler la
béance ainsi créée par la tension des deux autres, la mise en intrigue,
qui transforme la temporalité sédimentée en ascendance. Elle fera de la succession
des survenir la quête par le sujet d'une expérience pratique et
de ce fait l'acquisition d'un nouveau savoir et une affirmation
de soi.
II) La tension entre survenir et attente noologique :
les emplois de "encore" et "déjà" dans "Osiris
ou la fuite en Égypte".
A partir du
moment donc où le sujet est constitué comme
tel, où il se construit une attente, il se trouve en tension avec
le survenir ou sa prévision. Il se crée donc comme effet de sens
toute une dialectique particulière dont nous voudrions montrer
une illustration à travers un poème de Jacques Prévert.
Si l'on voulait
analyser très schématiquement
le poème— voir le texte en appendice — on pourrait dire
qu'il oppose deux séries de programmes narratifs, qui sont mis
en tension :
/100/
1) Des programmes 'bourgeois idolâtres'
qui serviraient de fond :
- Le
vers 22 fait allusion à
" Toutes les idoles mortes des églises
de Paris"
où se tiennent les mariages officiels.
Ceci sert d'indice pour convoquer le motif du "mariage" "bourgeois" "idolâtre" comme
fond polémique servant de repoussoir par rapport au "mariage" particulier
des deux amants.
- À cette évocation polémique de la morale
bourgeoise doit être lié le fond de guerre mis en perspective dès
le début du poème.
2)
Des programmes 'naturels et païens' qui serviront
de motifs mis en accent :
- le sourire
de la ville illuminée par l'été
- surtout
le mariage païen et privé de deux amants qui s'embrassent avec
la bénédiction d'un Osiris, dieu égyptien ressuscité des morts.
Dans cette
stratification, on peut observer que le conflit le plus saillant
est celui de la guerre et de l'amour,
qui sont plus particulièrement focalisés dans le fonctionnement
discursif du poème. La guerre est l'objet de trois résistances
: celle de l'été, de la ville et des amants. Deux de ces amants
occupent l'essentiel de la longueur du poème qui raconte leur "histoire".
En outre ils bénéficient, comme tous ceux qui s'aiment, du sourire
d'été offert par la ville. La guerre fonctionnerait donc comme
anti-destinateur par rapport à la ville et à Osiris. C'est à travers
ce contexte que l'on va pouvoir analyser comment les adverbes "encore" et "déjà" vont
opposer les diverses modes d'anticipation et le survenir.
A. "Déjà l’été, encore la guerre" vers
2
La première remarque que l'on pourrait faire,
consiste à observer /101/ l'aspect inchoatif du "déjà" qui
correspond au survenir de l'entrée dans une durée, présentée comme
soudaine. "Encore" de son côté serait duratif et itératif,
en ce sens qu'il signifie, comme l'a montré Catherine Fuchs dans
sa communication au colloque de 1992, une quantité supplémentaire
de durée pour une même entité (qui peut être aussi bien un état
qu'un procès, si l'on sort du cas spécifique de l'itération). Comme le dit Catherine Fuchs, (p.140). "Encore" marque
qu'on ajoute des nouveaux syntagmes à une durée.
Si l'on veut
gloser l'effet de sens thymique de chacune des deux expressions,
on peut dire que "déjà" exprime
une surprise. Il y a là ce que Claude Zilberberg appelle, si j'ai
bien compris, un "effet de concession" :
dans la prévision de l'observateur présupposé par le texte, l'été ne
devait pas arriver.
Si "déjà" exprime la surprise, "encore",
lui, crée un effet de sens, atténué d'ailleurs, de scandale. La
prolongation de l'absurdité guerrière se met en tension avec l'attente
de sa fin. Alors que dans le cas de "déjà", l'attente
pouvait être objectivée en simple prévision cognitive, il y a ici,
semble-t-il, attente déçue.
Pour reprendre
l'analyse très pertinente que
fait Claude Zilberberg dans l'article qu'il a publié dans Sémiotique
et Bible, n°69, on peut décrire l'excès comme une tension entre
la démarcation qui
pose des limites et la segmentation qui
constate objectivement des positions intermédiaires.
Si l'on applique
ce schéma à l'effet
de sens de nos deux adverbes, on s'aperçoit que "déjà" correspond à un
survenir qui précède la démarcation prévue, alors que "encore" correspond à une
sédimentation de survenir repensée comme une contre-ascendance
/102/ qui dépasserait la démarcation attendue. "Encore" correspondrait
donc à un excès d'ascendance de la part de la guerre.

A la vue du
schéma, on pourrait penser que "déjà" ne
signifierait pas à un excès mais un manque, en raison du fait que,
dans le sens de l'ascendance, la segmentation précède la démarcation.
Mais un retour purement intuitif sur l'effet de sens perçu conduit à refuser
que le "déjà" puisse être lié à un manque. Nous avançons
donc l'hypothèse que "déjà" correspond ici à la mise
en perspective du temps objectif —descendant— tandis que "encore" jouerait
dans la direction temporelle ascendante. "Déjà" sert à constater
un survenu, antérieur la prévision, envisagé depuis le lieu même
où il se réalise, encore semble plutôt marquer une augmentation
vers le futur, observée ici depuis le lieu de la démarcation./103/
B) "sourit, sourit
encore" vers 4
Ce deuxième exemple confirme ce qui vient d'être
dit de "encore". "Encore" est, au vers 4, un
exemple quasi-canonique d'itération, avec un tempo créé par tout
le contexte d'itérations prises en charge sur le plan de l'expression.
Nous ne referons pas la démonstration de Catherine Fuchs. Il y
a bien ici insistance sur une augmentation de durée ou une itération
du procès, conçu en ascendance.
Mais l'itération a un autre intérêt, elle est
facteur de renforcement métaphorique. En effet ce sourire de la
ville qu'on peut mettre en relation figurative avec l'éclat du
soleil de l'été sur la même ville, est une figure métaphorique
qui sert à impliciter toute la joie et la sympathie transmise aux
amants par la ville illuminée de soleil, à cause de l'été. "Encore",
par la récurrence du procès qu'il signifie, crée donc un effet
de sens d'intensification.
Il reste que
la duplication même du mot signifie
l'ampleur d'un besoin directement créé par la guerre. Le contexte
n'est plus aspectualisé par l'excès mais plutôt il présuppose un
manque. La segmentation provoquée par un survenir se trouve en
ajouter un segment nouveau sans avoir atteint la limite désirée.
On se trouve donc à nouveau dans un emploi qui sert à mettre en
discours une tension. Mais on s'aperçoit que cette signification
est créée par le contexte modal, elle n'est pas contenue dans le
signifié des lexèmes. "Encore" qui correspondait à l'expression
de l'excès devient ici, du fait du contexte modal, la manifestation
d'un manque.
III) Une configuration sensible : la tension dramatique.
Le
combat décisif dans une
série Américaine.
Lorsque ce
conflit entre "l'à-venir" et
le survenir prend l'ampleur d'une disposition modale, il se manifeste
sous la forme d'une véritable configuration sensibilisée, généralement
convoquée par le spectateur et que l'on peut décrire comme la "tension
dramatique".
/104/
Il sera facile
de percevoir la configuration pathémique, si l'on essaie de rendre compte schématiquement de
certains combats à mains nues que l'on peut trouver dans un western
ou mieux dans une série policière américaine. Nous choisirons le
deuxième exemple parce qu'il nous semble constituer un motif fondamental
dans la culture médiatique actuelle.
Nous recourrons
ici à un exemple qui ne se
réfère pas à un objet textuel précis mais au schème général dont
le lecteur reconnaîtra l'évidence. Nous nous écartons donc ici,
dans notre démarche méthodologique, du principe d'immanence, selon
lequel on ne pourrait mener d'analyses du contenu qu'à partir de
manifestations textuelles, elles seules pouvant présupposer un
signifié "immanent" doué de quelque objectivité. En fait,
l'application stricte de ce principe méthodologique nous paraît,
tout bien pesé, assez illusoire. Même
si l'on pouvait rêver d'un travail d'analyse de la forme du contenu
qui laisse de côté toute intuition pour relever d'une objectivité rigoureuse,
nous devons constater que
l'analyste ne peut pas échapper à la paraphrase des configurations
qu'il reconnaît dans la lecture d'un objet textuel, à une glose par
laquelle il se donne les moyens de prendre conscience de la textualisation
pour ne pas dire de la mise en discours qu'il a construite dans
son fort intérieur.
Dans le cas
qui nous intéresse, il serait artificiel
d'extraire un quelconque objet textuel qui décrirait une tension
dramatique. La tension dramatique n'est pas manifestée
par le texte, elle est un pathème convoqué par le spectateur. Il
faudrait donc trouver un texte qui analyse ce vécu du spectateur.
Or un texte qui représenterait ce vécu /105/ serait aussi intuitif
et subjectif que la glose que nous essaierons de faire valider
ici. C'est pourquoi nous nous contenterons de mener une première
analyse à partir du sentiment commun que nous pensons pouvoir partager
avec nos lecteurs, qui ont tous eu l'expérience de ce type de configurations
passionnelles. Il s'agira d'une glose textuelle comme une autre.
Ajoutons que
dans le cas de cette configuration pathémique, on se heurte pour la décrire à une forte variabilité dans
son développement, selon les individus, voire même les instants
vécus par chacun. Nous tenterons de réduire cette variabilité par
la mise en texte volontaire d'une caricature qui conserve les traits
les plus généraux de cette expérience sensible. De toute façon,
il y tout lieu de penser que l'essentiel apparaîtra à tous, à savoir
la tension entre prévision et attente qui la constitue, elle-même
sanctionnée par la nécessité ontique des survenir.
Nous décrirons donc le motif du combat décisif à coups
de poings de la façon suivante : au cours d'une séquence truffée
de péripéties, on voit le héros souffrir du fait d'un adversaire
qui le met à mal pendant très longtemps. L'objectif des auteurs,
dont on sait l'intérêt qu'ils ont à donner des sensations fortes à leurs
spectateurs, est d'intensifier l'effet de tension dramatique dans
cette confusion qui laisse croire, qui laisse craindre que le héros
puisse ne pas l'emporter. Et il arrive parfois que ce soit le cas
et voilà notre homme prisonnier des bandits, alors qu'on attendait
qu'il les mette hors d'état de nuire. Mais il suffirait de regarder
sa montre et l'on saurait qu'il ne reste plus beaucoup de temps
donc que cette confusion finira bien. L'attendu de l'image but
se réalisera et l'on verra le méchant assommé ou tué, en tout cas
mis en échec dans sa propre intentionnalité.
Nous voudrions,
en reprenant les notions avancées
par Greimas-Fontanille dans Sémiotique des passions, essayer d'analyser cette configuration pathémique, que cherche à provoquer
l'élongation caractéristique des ces scènes.
Constitution
Pour rendre
compte du dispositif qui est à la
source de ce pathème, il faut retrouver les actants et le dispositif
modal qui semblent présupposés par celui-ci. On constatera alors
qu'il s'appuie sur la situation polémique dont nous avons parlé :
le dispositif doit conduire à opposer une attente avec les événements
(le flux des survenir).
Dans ce type
de scènes dramatiques, on peut
trouver au moins deux actants en situation polémique, observés
par un troisième actant, le spectateur présupposé, qui convoquera
la tension dramatique. Autrement dit deux "contre devenir" doivent être
modalisés à l'inverse /106/ par cet observateur noologique. Cette
double modalisation peut se référer au /vouloir/ ou au /devoir/,
sans que cela change fondamentalement la configuration, en dehors
de son intensité. Le
déontique donnerait en effet plus de force à l'émotion qu'un simple
volitif. Si l'on appelle PN1 le
programme de l'adversaire et PN2 celui
du héros, on aurait donc les deux systèmes de modalités suivants :
/Ne
pas Vouloir être/
sur PN1 vs /Vouloir être/ sur PN2
ou
/Ne
pas Devoir être/
sur PN1 vs /Devoir être/ sur PN2
La modalité appliquée à l'un est donc niée
pour l'autre. La présence de cette négation conditionne la convocation
de la disposition sensible. Tout ceci est en relation avec une
attente repoussée par les péripéties à l'extrême profondeur de "l'à-venir" :
l'image but de la victoire attendue qui potentialise directement
celle-ci, en oubliant, si l'on peut dire, les préconditions objectives
de son advenue. Il y a un désir secret de l'exécution immédiate
de cette image, source d'impatience, dans l'oubli complet des réalités.
Or il y a
double potentialité, car double devenir
convoqué. L'anti-sujet est bien là avec sa résistance laissant
prévoir une défaite. Seul le temps objectif va trancher, encore
une fois.
Notons que
l'image but ne doit pas être confondue
avec la figure rêvée d'un état ou d'un procès de la sémiotique
du monde naturel. L'attente de sa survenue est telle qu'il semble
que la victoire ne peut pas ne pas être, ce qui dispense le spectateur,
voire l'empêche de se la représenter au niveau figuratif. Elle
s'impose donc comme une forte tension ressentie par le public,
indépendamment des figures convoquées pour l'imaginer en détail.
Certes certains narrataires peuvent convertir celle-ci par l'évocation
de figures précises, mais ce n'est pas nécessaire pour qu'il y
ait image but. Il suffit qu'il y ait, de la part du narrataire,
oubli des présupposés du réel et focalisation sur /107/ cette seule
attente.
De plus une loi du genre renforce cette conviction : de toute
façon le bon doit gagner.
Il existe
une autre condition propre à ce type
de configuration. Il faut que le Sujet soit effectivement potentialisé : le /Pouvoir Faire/ du héros
semble total. Le policier a épuisé le /Savoir Faire/ puisqu'il
a identifié le coupable, l'a localisé et s'est rendu à l'endroit
où il pouvait le trouver.
Sensibilisation
Toutes les
conditions sont donc réunies pour
qu'il y ait convocation par l'observateur noologique de la tension
dramatique. La succession rapide d'événements permet de renforcer
l'intensité de l'impression. Toutefois, si la victoire a l'éclat
de la soudaineté, l'émotion sera certes forte mais bien rapide.
La tension dramatique voit donc son intensité reposer sur tous
les moyens de l'élongation.
On peut avoir
un allongement de la durée :
l'anti-sujet se cache. Le policier se trouve souvent alors, comme
nous l'avons dit, dans une sorte de labyrinthe. Et plus on attend,
moins la croyance dans la réussite du héros est possible. Il risque
trop de se faire surprendre.
Le plus souvent
ce sera l'itération, provoquant
un foisonnement d'événements donc une accélération du tempo, qui
remet en cause aussi la croyance en la potentialité de l'image
but. L'adversaire n'arrête pas de mettre à terre le héros, qui
souffre. Le narrataire ne croit plus à la réussite du personnage.
Le processus sera renforcé si le sujet /108/ pathémique a tendance à exacerber
la tension d'origine modale sous la forme d'une oscillation thymique
entre l'espéré et le craint. Car il existe une contre image but
: la survenue de la victoire du méchant. Celle-ci est souvent mise
en discours par un motif discursif courant : le héros ne rentre
pas sans précaution dans le lieu où doit se trouver son adversaire.
Il s'agit en effet de se méfier, de ne pas se faire surprendre.
Ce faisant, on crée un effet d'effroi, les assistants ne sachant
pas qui va surprendre l'autre, surtout, si pour renforcer la tension
dramatique, on place la recherche dans un lieu particulièrement
labyrinthique.
C'est alors
que se produit la pathématisation.
Cette perte de confiance, en opposition avec l'attente, crée une
forte oppression, quasi-physique, qui peut s'accroître jusqu'à un
déséquilibre complet de la sensibilité. L'espoir cède à la crainte
puis la crainte à l'espoir et vice versa… Le narrataire se trouve
assailli par l'émotion, elle-même manifestée par une tension physique
forte, voire même par l'apparition de larmes. Plus l'auteur invente
de péripéties inquiétantes, plus la crainte gagne dans la confusion
des sentiments.
L'intensité sensible peut convoquer alors cette
forme indécise de protensivité où sujet et anti-sujet deviennent
interchangeables. Il arrive parfois que le spectateur change de
camp et prenne une autre position actantielle, en adoptant cyniquement
la position du bandit.
Moralisation
L'intervention
de la moralisation pour ce dispositif est particulièrement complexe. Ce qui ajoute sans doute, au niveau éthique, à la
confusion fiduciaire. La tension dramatique n'est pas une passion,
au sens que donne Sémantique des passions,
dans la mesure où, dans notre culture dominante actuelle, on ne
lui accorde pas le caractère d'un excès. Elle est liée toutefois
au scandale de l'événement non compatible avec l'éthique présupposée
par le récit. Si le bandit gagne, c'est un véritable déni à la
vertu. Car le scélérat est, de toute évidence, très dangereux pour
la sécurité de la ville.
Deux facteurs
conduisent cependant à considérer
la tension dramatique comme excessive et donc à refuser de "marcher",
sauf si l'on est "passionnel" :
/109/
• Le
reproche d'invraisemblance.
• L'excès mélodramatique
dans la manifestation de la thymie. Il existe des convenances.
C'est ainsi que le metteur en scène doit procéder dans sa direction
d'acteurs à des réglages très fins pour accentuer la thymie dramatique
(cris, faciès de souffrance etc…) tout en restant dans des limites
difficiles à régler, au-delà desquelles le public jugera qu'il
y a artifice.
Conclusion
Dans la culture
encore romantique qui est la nôtre, il semble que beaucoup de récits
impliquent, plus ou moins, une tension dramatique. En effet tout héros de récit est inscrit dans
l'ascendance de la quête d'un objet de valeur et par ce fait, d'une
identité. Souvent il se heurte à un contre-sujet, qui développe
de son côté une contre ascendance.
On opposera
donc deux devenir, correspondant à deux
perspectives noologiques contraires qui peuvent convoquer chacune
une attente — liée à une image-but plus ou moins précise — et
une prévision qui lui permettra de l'emporter en compétence donc
de gagner l'épreuve. Comme tout univers noologique présuppose
un énonciateur pour l'énoncer, on peut stipuler derrière chaque
perspective une instance d'énonciation donc une voix particulière. C'est pourquoi nous aurions envie d'emprunter à la
pragmatique la notion de polyphonie pour décrire une tension de ce type.
/110/
Le conflit
des deux devenir ainsi convoqués
est tranché lui-même par une troisième voix, la succession plus
ou moins espacée des surprises du survenir, dont le sujet destinateur
est assimilé selon les cultures au destin ou au hasard ou à l'énonciateur
démiurge qui a construit la fiction.
Si, plus simplement,
le récit développe un
seul programme, le survenir résout la tension qui existe entre
l'attente et l'état d'avancement pragmatique du programme narratif.
De toute façon, on retrouve cette espèce de polyphonie particulière
puisque décadence du survenir et ascendance du projet sont des
perspectives opposées dans la saisie de la temporalité.
Il se trouve
que dans ce "chœur de voix",
le survenir a une force, un éclat particuliers. En effet tout objectif
qu'il soit, le survenir apparaît à l'observateur comme délimitant
le champ du possible en le transformant en révolu. De ce fait,
il résout objectivement le conflit entre l'incidence et la décadence,
lieu de signification qui convoque l'expérience primordiale de
cette schizie de la masse phorique par laquelle l'ego s'affirme
par son attente (selon une logique d'ascendance) tout en tentant
de "prévoir" un devenir objectivé (advenir décadent).
Et cette tension
entre l' "à venir" et
le survenir, nous la trouvons à tous les niveaux de la signification.
Il a tout lieu de penser qu'elle joue aussi son rôle dans le face à face
perceptif du sujet humain en agir dans le monde. Toute perception
vise à unifier dans des catégories perceptives le flux dissolvant,
au tempo rapide des stimuli sensibles envoyés par le monde. L'ascendance
de la catégorisation perceptive selon l'agir s'oppose à la décadence
du flux des sensations. Ne pourrait-on donc pas envisager d'ajouter
ces grandeurs à la liste des grandeurs figurales ? La saisie du
temps présupposerait non seulement un tempo mais des directionnalités
préfigurant les modalisations : les modalités fiduciaires
et déontiques relevant de la prise en compte de la descendance,
les modalités de la quête (vouloir, savoir, pouvoir) relevant d'une
construction de l'ascendance, comme permanence de l'ego agissant.
Ce bref parcours a montré en effet qu'elles apparaissent à la fois
dans l'aspectualisation démarcative et dans la pathématisation
dramatique. Nous fondant sur les descriptions faites par les disciples
de Robert Lafont, nous avons envisagé que la mise en récit présupposerait
aussi cette double direction du temps. Beaucoup de linguistes considèrent
que Guillaume l'a bien mise en évidence pour décrire le sémantisme
temporel articulé dans plusieurs langues. Si elle apparaît à tant
de niveaux, peut-on faire l'économie de lui donner un statut fondamental ?
En tous cas,
la prise en compte du survenir dans la signification /111/ nous
semble particulièrement importante.
Il s'avère finalement que tout survenir, dans sa ponctualité clôturante,
implicite le faire et les compétences qu'il a présupposées —même
s'il épuise le pouvoir de ces dernières, puisque que le faire lui-même
a été réduit en révolu par la frontière du survenir. La mise en
discours d'un événement consiste toujours en une glose expansionnalisante
de l'expérience fusionnée, mémorisée par le sujet à la suite du
survenir la clôturant. Cette glose résulte d'opérations qui constitueront
la mise en intrigue et la mimésis. Celles -ci non seulement
expliciteront le contenu détaillé de l'événement principal mais
encore analyseront en ascendance l'ensemble des conditions qui
l'expliquent. Par contre un titre, une simple désignation résomptive
va ponctualiser le récit en un unique survenir, conçu comme une
globalité d'ascendance.
A tout bien
considérer, il semble qu'on pourrait
retrouver là tout un mode de fonctionnement de la sémiosis. Il s'avère en effet que l'observation des
langues comme systèmes de différences, ou mieux de différenciations
dans la dépendance, aboutit à une constatation de même genre. De
même que ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit. Le faire
sémiotique en action à travers l'énonciation d'un lexème est bien
l'acte de créer la survenue d'un signifiant qui implicite toute
une potentialité de signifiance dont peut rendre compte une glose
sémantique, qui en serait comme la mise en intrigue et la mimésis.
Agir ou dire, raconter ou expliquer c'est, de toute façon, s'affirmer
en ascendance, à partir de la décadence des survenues. A travers
la sémiosis, on retrouverait donc toute la complexité de la praxis.
Bibliographie
Brès,
Jacques, 1993, Récit oral et production d'identité sociale, Montpellier, Praxiling.
Brès,
Jacques, 1994, La
Narrativité, Louvain,
Ducolot.
Coquet, J.C., 1989, Le discours et son sujet, tome I, Paris, Klinksieck.
Fontanille, Jacques, 1989, Les
espaces subjectifs : introduction à la
sémiotique de l’observateur, Paris,
Hachette.
Fontanille,
Jacques, 1993, « La base perceptive de
la sémiotique », exposé au séminaire en novembre 93, à paraître
dans Degrés.
Fuchs,
Catherine, 1992, « Modulations qualitative sur l’itération,
les emplois concurrentiels de encore et
de re- », in Fontanille La quantité et
ses modulations qualitatives, pp. 129-142 Limoges
Amsterdam, PULIM/ Benjamins, 1992.
Greimas, A. J., 1979, Sémiotique, dictionnaire raisonné de
la théorie de la langue, tome
1, Paris Hachette.
Greimas A.J. et Fontanille J., 1991, Sémiotique
des passions, Paris, Le Seuil.
Guillaume, Gustave, 1929, Temps
et verbe Théorie des aspects,
des modes et des temps, édition
1984, Paris, Champion.
Lafont, Robert, 1978, Le travail et la langue, Paris, Flammarion.
Ricœur,
Paul, 1983-1985, Temps
et récit, 3 tomes, Paris, Le Seuil.
Sadoulet,
Pierre, 1985, « Le lexème et son contexte. Réflexions à partir
de astu et polis », Ktema n°10, Strasbourg.
Zilberberg,
Claude, 1993, « Analyse discursive et énonciation » ,Sémiotique
et Bible n° 69, mars 1993, Lyon.
Osiris
ou La fuite en Égypte
C'est
la guerre c'est l'été
Déjà l'été encore
la guerre
Et la
ville isolée désolée
Sourit sourit encore
Sourit
sourit quand même
De son
doux regard d'été
Sourit
doucement à ceux qui s'aiment
C'est
la guerre et c'est l'été
Un homme avec une femme
Marchent
dans un musée
Leurs
pas sont les seuls pas de ce musée désert
Ce musée
c'est le Louvre
Cette ville c'est Paris
Et la
fraîcheur du monde
Est là tout
endormie
Un gardien
se réveille en entendant les pas
Appuie
sur un bouton et retombe dans son rêve
Cependant
qu'apparaît dans sa niche de pierre
La merveille
de L'Égypte debout dans sa lumière
La statue d'Osiris vivante dans le bois mort
Vivante à faire
mourir une nouvelle fois de plus
Toutes
les idoles mortes des églises de Paris
Et les amants s'embrassent
Osiris les marie
Et puis rentre dans l'ombre
De sa vivante nuit.
Jacques
Prévert, Paroles
Article publié le 10 novembre 2005